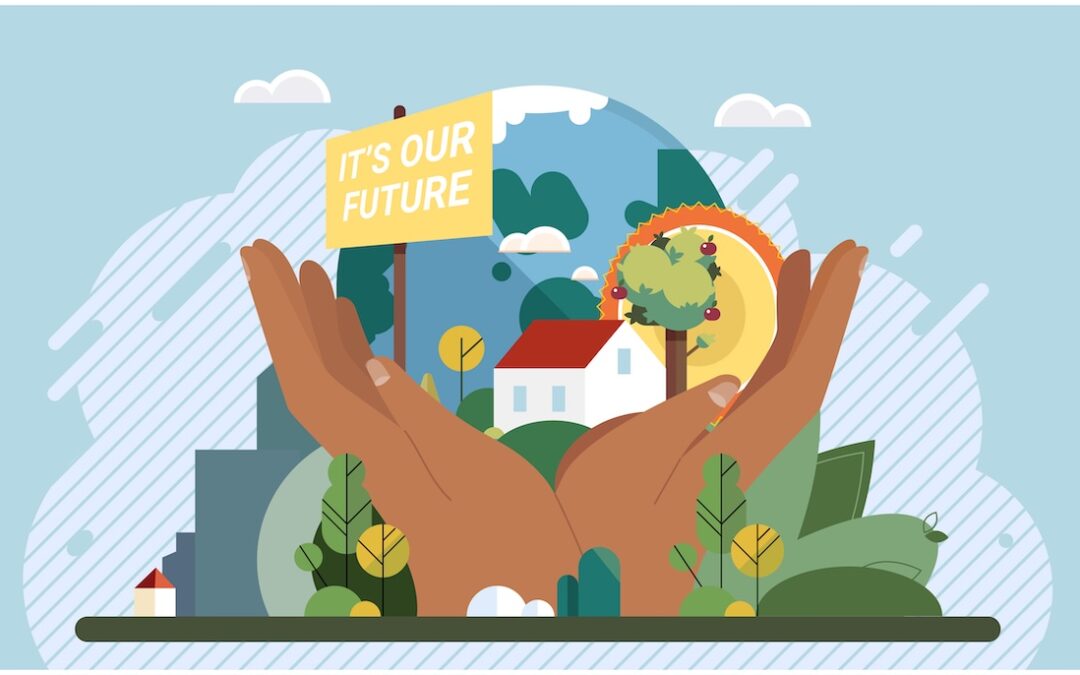Face à l’urgence climatique et aux inégalités sociales croissantes, les professionnel·les de la santé et du social se retrouvent à un carrefour décisif : comment soigner les populations humaines tout en prenant soin de la planète, qui elle-même influence notre santé ? Comment intégrer les enjeux de durabilité dans les pratiques cliniques quotidiennes ?
Notre conférence en ligne, intitulée “Santé durable : le rôle clé des professionnel·les de la santé et du social”, propose d’explorer un levier souvent sous-estimé : la promotion de l’activité physique — en l’intégrant dans un raisonnement clinique élargi et une communication éclairée sur les liens entre santé humaine et durabilité.
Dans cette conférence, nous commençons par un bref rappel des enjeux de durabilité liés au système de santé, avec un focus sur la situation suisse et les ressources mobilisables à l’échelle locale. Par exemple, la Revue Médicale Suisse met à disposition 12 infographies en français, allemand et italien sur des pratiques en santé durable (12 mois 12 actions | Revue Medicale Suisse).
Puis, nous posons les bases d’un raisonnement clinique durable : comment, en tant que professionnel·le de santé ou du social, pouvons-nous évaluer une situation en tenant compte non seulement de la santé individuelle, mais aussi de son contexte environnemental et social ? Nous proposons d’intégrer un modèle de raisonnement clinique durable (Senn et al., 2022) dans sa pratique. Ce modèle repose sur deux axes : le coûts-efficacité du traitement, et l’impact environnemental de ce dernier afin de guider et éclairer les différents choix thérapeutiques. Nous présentons ensuite un exemple concret visant à enrichir la théorie et à illustrer comment ce cadre peut soutenir, de manière plus systémique, nos décisions cliniques en faveur d’un raisonnement durable.
Nous approfondissons ensuite cette thématique avec un exemple pratique : l’activité physique comme levier de santé durable (Organisation mondiale de la Santé, 2019). En tant que facteur de promotion de la santé et prévention, elle devient ici un outil transversal, capable de répondre à des enjeux de santé tout en encourageant des modes de vie plus respectueux de l’environnement : mobilité active, lien social, réduction du recours aux soins médicamenteux, etc. Nous donnons des pistes sur comment soutenir un changement de comportement durable et adapté à la personne grâce à une conversion brève en changement comportemental, ainsi que des ressources pratiques à utiliser avec les usager·ères du système de soins (par exemple, Ressources | Move Your Baby et PAPRICA | Promotion de l’activité physique au cabinet médical).
Enfin, en nous appuyant sur la boîte à outils de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (Communicating on climate change and health: Toolkit for health professionals),
nous explorons des stratégies de communication efficaces pour renforcer la sensibilisation aux liens entre santé et changement climatique, qui peut être, par analogie, élargi aux dégradations environnementales au sens large. Ces outils peuvent aider les professionnel·les à utiliser leur position privilégiée de confiance auprès des patient·es, bénéficiaires et usager·ères pour susciter une prise de conscience et encourager des transitions durables à l’échelle individuelle comme collective. En résumé, les changements environnementaux, dont le changement climatique, ont déjà un effet délétère majeure sur la santé des populations, c’est pourquoi la mise en place de solutions pouvant atténuer ces changements environnementaux a des effets positifs sur le bien-être et la santé humaine. L’OMS propose que les professionnel·les de la santé ne se demandent pas SI mais COMMENT parler du changement climatique et de ses effets sur la santé humaine à leur patientèle. Les recommandations principales peuvent être résumées ainsi : garder un message simple à répéter souvent, particulièrement lors d’évènements extrêmes et attribuables au changement climatique; de garder le focus sur la santé individuelle et non les aspects environnementaux ; de donner des outils adaptés à la situation locale aux populations pour se protéger de ces évènements extrêmes; et finalement de ne pas débattre des évidences scientifiques qui font consensus (World Health Organization, 2024).
Pour aller plus loin, nous vous invitions à visionner notre conférence (60 minutes de présentation, 15 minutes d’échange). Cette conférence s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent élargir leur cadre de réflexion et d’action pour faire de leur pratique un vecteur de santé globale, équitable et durable.

Fanny Poget (MSc)
Maître d’enseignement, HESAV Lausanne
Fanny enseigne en physiothérapie principalement dans le domaine musculo-squelettique, avec un intérêt particulier pour le raisonnement clinique, l’autonomisation des patients, l’activité physique, ainsi que par les enjeux futurs de la profession en lien avec la santé publique, tels que durabilité et efficience thérapeutique.

Mathilde Hyvärinen
Spécialiste en activité physique adaptée et collaboratrice scientifique à HESAV
Mathilde Hyvärinen est spécialiste en Activités Physiques Adaptées (APA) avec plus de 8 ans d’expérience en santé publique. Elle enseigne et mène des projets de rechercher en promotion de l’activité physique à la Haute École de Santé – Vaud (HESAV, Lausanne, Suisse).
Références
Senn, N., Gaille, M., del Rio Carral, M. & Gonzalez Holguera, J. (2022). Santé et environnement: Vers une nouvelle approche globale. Chêne-Bourg : RMS éditions / Médecine et Hygiène.
Organisation mondiale de la Santé. (2019). Plan d’action mondial de l’OMS pour promouvoir l’activité physique 2018-2030 : Des personnes plus actives pour un monde plus sain [Global action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world]. Organisation mondiale de la Santé, Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327168/9789242514186-fre.pdf
World Health Organization (2024). Communicating on climate change and health: toolkit for health professionals. https://www.who.int/publications/i/item/9789240090224
Déclaration d’assistance par intelligence artificielle
Ce texte n’a pas été rédigé à l’aide d’un modèle de langage d’IA. L’IA, Microsoft® Copilot, a été utilisée pour vérifier la grammaire et l’orthographe. Les auteures ont examiné les corrections proposées par l’IA afin d’en assurer la précision, la pertinence et la cohérence avant de finaliser le texte.